Le grand cheval des Trois-Pistoles
On raconte qu’aux Trois-Pistoles, par temps de brume et de nuages, lorsque le vent se lève, il arrive qu’un grand cheval noir, plus large qu’un taureau, surgisse de nulle part, sans prévenir. La bête est débridée, orgueilleuse, indomptable, enfiévrée. Dans un fracas de sabots, avec des hennissements à faire taire les oiseaux, elle court sans jamais perdre haleine.
Le diable, selon la légende, s’était emmêlé à la crinière de certains chevaux fougueux à l’heure où la population s’affairait à construire ces monuments démesurés que sont les églises. Des ouvriers, peut-être en quête de leur propre liberté, les auraient alors libérés. Ainsi affranchies, ces bêtes endiablées ne réapparaissent plus à la masse de la population que dans les replis des jours, dans l’espoir fragile qu’elles avaient alors de faire courir le monde sur les chemins de la liberté.
Victor-Lévy Beaulieu fut à sa manière l’un de ces chevaux fougueux. Samedi, à l’occasion de ses funérailles aux Trois-Pistoles, il pleuvait. Le ciel était plein de brume. J’ai rappelé, au milieu des mots de l’écrivain portés par des comédiens, que Victor-Lévy regrettait de vivre dans un monde souvent incapable de saisir la magie de se dire et de se rêver. Si nous nageons aujourd’hui dans la déliquescence sociale, disait-il, c’est parce que ceux qui nous gouvernent ont renié l’évidence : nous sommes avant tout des êtres culturels. « Le pays que je veux », écrivait Victor-Lévy, « est bien au-delà des mots que je peux écrire. Le pays que je veux parle d’affranchissement collectif et non pas de ma simple mort à........

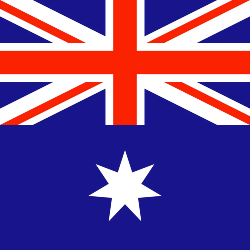

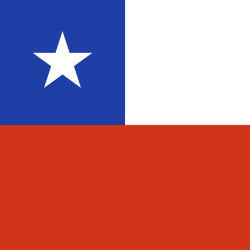














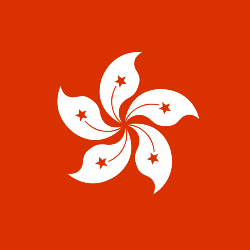



 Toi Staff
Toi Staff Gideon Levy
Gideon Levy Sabine Sterk
Sabine Sterk Stefano Lusa
Stefano Lusa John Nosta
John Nosta Gilles Touboul
Gilles Touboul Mark Travers Ph.d
Mark Travers Ph.d Tarik Cyril Amar
Tarik Cyril Amar Daniel Orenstein
Daniel Orenstein
